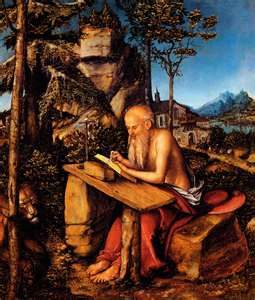
Dans le chapitre 14 des Actes, nous voyons Paul et Barnabé évangéliser des villes d’Asie Mineure. Ils y demeurent “quelque temps” (semaines, mois ?), désignent des “anciens” pour encadrer les communautés et partent ailleurs. Leur annonce devait être fondamentale mais sommaire : le kérygme, l’amour du prochain et le repas eucharistique vécus, quelques éléments de l’ancien testament que les convertis d’origine juive devaient compléter. Pourquoi, de nos jours, faut-il près de dix ans pour former un “presbyteroï” ? Est-il indispensable d’avoir lu Aristote, St Thomas, les Pères de l’Eglise pour être prêtre ? Diacre en milieu rural, j’utilise surtout les fondamentaux acquis depuis mon enfance pour prêcher et préparer aux sacrements, et assez peu la formation universitaire reçue, très au-dessus du niveau de mes paroissiens. Quant à la durée de la formation, on sait qu’elle n’est pas une garantie de la solidité d’une vocation.
[Nous invitons nos lecteurs à poser leurs questions dans les commentaires de nos articles car les questions ne nous parviennent plus autrement. Nous rappellerons ce message tant que le problème informatique ne sera pas réglé]
Si on suit le raisonnement jusqu’au bout, pourquoi apprendre à lire ? Il nous semble au contraire qu’être bien formé est un atout dans la vie, et pas seulement en matière de spiritualité.
D’une part, Paul et Barnabé évoluaient dans un monde où le divin était une évidence et où de nombreuses notions théologiques étaient donc admises par tous, y compris les païens. De même, quand ils prêchaient, c’était d’abord aux Juifs ou prosélytes, donc ces derniers connaissaient très bien l’Ecriture et la théologie qui va avec. En clair, ils avaient les bases de catéchisme.
Ces personnes étaient aussi pétries de culture grecque. Les plus éduqués avaient, justement, lu Aristote. Donc heureusement pour lui que Paul avait la formation rabbinique – comme Pharisien disciple de Gamaliel – et hellénistique – comme son grec élégant le montre – pour parler. Dans le discours d’Athènes en Ac 17, il cite Eschyle et son discours est emprunt de philosophie stoïcienne. Il est donc l’exact contrepoint de ce que recommande l’auteur de cette question.
Pour en venir à nos jours, nos lecteurs connaissent certainement des « générations X » jeunes dans les années 70 ou 80, et même plus tard, qui n’ont rien appris au caté et se moquent de l’indigence des dame caté qui leur faisaient faire du découpage et leur servait un discours d’empathie creux. Ils sont peut-être caricaturaux et injustes, mais nous avons suffisamment entendu ces critiques pour comprendre qu’elles ont un fond. Tous les catéchumènes que nous avons accompagnés, attendaient, au contraire d’avoir un accompagnateur qui ait du répondant et une formation solide.
Si le prêtre en sait moins que ses paroissiens, il ne va pas aller loin. Il y a certainement des différences de niveau culturel entre paroissiens, entre régions, entre classes sociales. Mais les gens s’abreuvent de bêtises plus ou moins ésotériques, de pensée positive, de bouddhisme mal digéré, que ce soit sur Internet, dans des magazines, des émissions de télévision, de la littérature bon marché etc. A part les personnes âgées, ils n’ont, le plus souvent qu’été peu ou mal catéchisés. Alors oui, il faut une pensée solide pour leur répondre. Et la foi chrétienne découle du judaïsme du Second Temple mais aussi de la philosophie grecque. On ne peut pas expliquer la Trinité ou l’Eucharistie si on ne sait même pas ce qu’est une substance, notion directement issue de la philosophie grecque. Le fidèle n’a peut-être pas à rentrer dans ces subtilités, mais si le prêcheur ne comprend même pas de quoi il parle, il ne tiendra pas la route à la première objection.
De même, on ne peut pas faire comprendre que, non, la réincarnation et la résurrection, ce n’est pas compatible, non, on ne peut pas être catholique et franc-maçon, non, toutes les religions ne disent pas la même chose, non, la Présence réelle dans les Saintes espèces, ce n’est pas qu’un symbole, non, Jésus n’est pas qu’un prophète comme le dit le Coran… Si on n’a pas une compréhension approfondie de ce dont on parle. Ou alors, on en reste à des slogans superficiels et l’argument d’autorité, et ça, ça ne passe plus.
Il est sidérant de réclamer de ne pas bien former les ministres ordonnés, là où, à la ville comme en banlieue ou à la campagne, les consacrées et les laïcs sont encouragés, au contraire, à se former, que les formations de théologie accessibles à tous se multiplient, pour évangéliser leurs contemporains. Quelqu’un qui aurait fait ses études de 1er cycle de théologie, par exemple, aurait noté qu’on forme un “presbuteros” et non un “presbyteroï” qui est un pluriel. Paul et Barnabé, en tous cas, l’auraient vu tout de suite.
